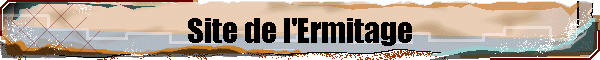
|
|
|
Le site médiéval de l’Ermitage
(commune de Paulhan)
Le site archéologique de l’Ermitage est situé sur la bordure occidentale de la moyenne vallée de l’Hérault. Il occupe le pied de versant septentrional d’un petit bassin alluvial aujourd’hui drainé par le ruisseau de Vareille ; les traces d’occupation sont plus précisément situées au point de débouché du modeste cours d’eau dans le lit majeur du fleuve proche. Menacé par les terrassements imposés par la construction de la future autoroute A75, le gisement fait l’objet d’une fouille de sauvetage depuis le 14 juin 1999 ; la date d’achèvement de l’opération est prévue pour le 31 octobre de cette même année. L’étude a été confie à une équipe d’archéologues de l’Association pour les Fouilles Archéologiques Nationnales oeuvrant sous contrôle scientifique du Service Archéologique Régional du Languedoc-Roussillon. La quasi-totalité des vestiges mis à jour à cette heure relève de la période médiévale. La datation antique de certaines des nombreuses traces parcellaires identifiées dans les limites de l’intervention ne doit pas être exclue, mais demande de complément d’étude avant d’être proposée sinon affirmée. Précisions qu’un établissement occupé durant les Ier-IIe siècles de notre ère, également en cours de fouille, est situé moins de 200m vers le Sud-Est. La grande majorité des aménagements reconnus date des Xe-XIe siècles. Doivent être tout d’abord mentionnées les traces d’un bâtiment situé à proximité immédiate de la rive gauche du ruisseau (en A sur le plan au dos). Si la mesure d’une telle découverte ne pourra être appréciée qu’au sortir des différentes analyses engagées à ce jour, l’extrême rareté des traces d’habitat sur les sites languedociens des alentours de l’an Mil suffit pourtant à relever le caractère important de la découverte. La structure massive des fondations mises au jour, corrélés aux découvertes d’un éperon en fer et d’une possible pièce d’arbalète invite d’ores et déjà à reconsidérer le postulat d’un habitat strictement paysan. A la périphérie immédiate de la zone bâtie ont été observés près de 250 silos creusés dans le terrain naturel et destinés à la conservation des céréales. Ces excavations, dont le grand nombre induit l’extension progressive d’une aire d’ensilage originelle, ont été comblées, une fois détériorées, par des déchets domestiques matérialisés par des fragments de céramiques et des reliefs de repas. Ces silos sont voisins de fossés et entretiennent avec eux des relations chroniques qui restent à préciser. Si l’occupation médiévale du gisement est avant tout signifiée par des installations datées des Xe-XIe siècles, plusieurs aménagements ( toujours des excavations) en cours d’études dans le quart-sud-est de la fouille avouent quant à eux des datations provisoirement situées dans le courant des VIe-VIIe siècles ; sous la forme de scories, de nombreux déchets liés à des activités métallurgiques ont été recueillis dans le comblement de certaines fosses. Sur la terrasse médiane du versant, des travaux ont par ailleurs révélé la présence de silos comblés dans le courant des XIIe-WIVe siècles. Ces éléments tardifs sont situés en bordure d’un chemin creux de direction nord-sud dont le point de contact avec le ruisseau de Vareilles a motivé un aménagement de la berge. Ce chemin se dirige vers l’église de Saint-Jean de Vareilles toujours en élévation et mentionnée au milieu du XIIe siècle.
|